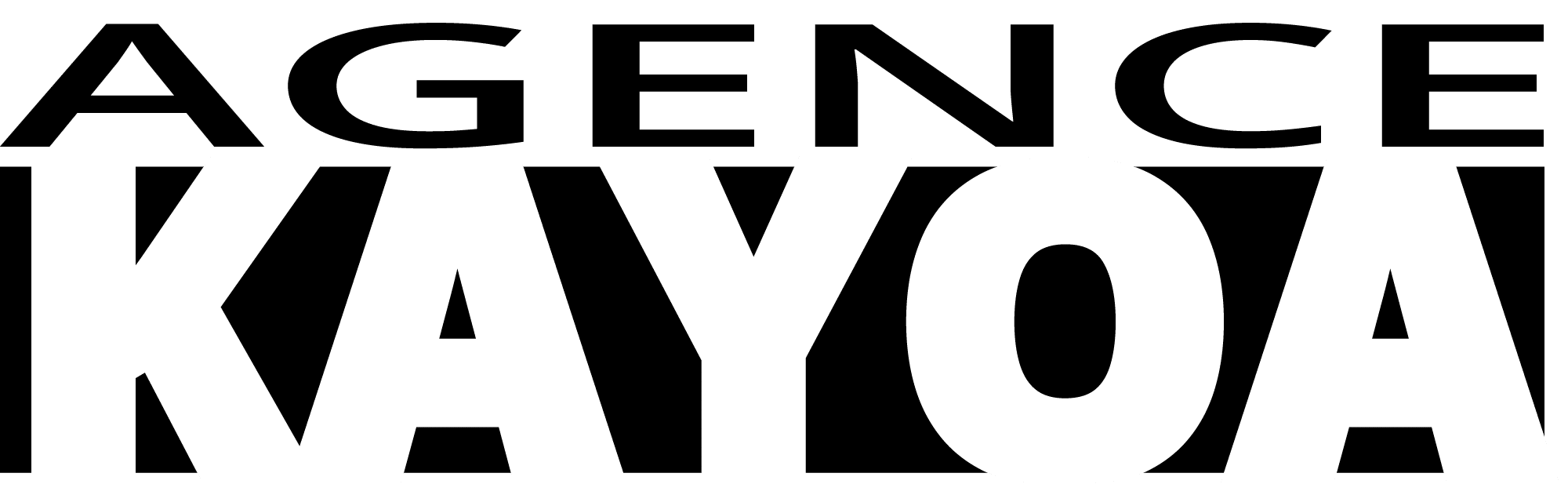Croyez-vous que des femmes qui se regroupent pour cuisiner font aussi de la politique? C’est ce que nous enseigne le livre de Gertrude Lavoie, « Les cuisines collectives au Québec : mémoires d’une pionnière » (Collectif québécois d’édition populaire, 2012). L’auteure de ce récit est une intervenante militante qui a travaillé dans la première cuisine collective du Québec. Celle qui aime partager la saine nutrition s’est énormément formée en recherche de financement, gouvernance et gestion stratégique d’OBNL.
La première cuisine collective au Québec
La cuisine collective est une activité de groupe où des personnes cuisinent ensemble des plats planifiés à l’avance, en se réunissant dans un organisme communautaire. Il existe aujourd’hui 1223 groupes de cuisines collectives au Québec mais comment tout ça a commencé? Au début du 20ème siècle, Hochelaga Maisonneuve était un quartier ouvrier avec des usines tournant à plein régime, jusqu’à la crise des années 30. Il s’est ensuivi la fermeture d’usines entrainant chômage et pauvreté. La solidarité s’est alors développée et des comités citoyens ont commencé à fleurir. En 1986, alors que des intervenantes du Carrefour familial Hochelaga opéraient des visites à domicile, elles ont découvert une pratique familiale intéressante chez un petit groupe de voisines qui cuisinaient en grande quantité et congelaient les plats. Appuyées par des citoyennes, les intervenantes ont souhaité reproduire l’expérience de cuisiner collectivement au niveau communautaire. Ainsi est née la Cuisine Collective d’Hochelaga Maisonneuve (CCHM), la première cuisine collective au Québec.
La mobilisation des partenaires
Pour reprendre l’expression de Gertrude, la CCHM est « une fleur cultivée par son environnement ». C’est en effet un projet structuré qui a fait de la mobilisation des partenaires l’ingrédient clé de sa recette. « Notre défi n’était pas dans le comment faire la cuisine […] il était dans comment devenir une organisation », écrit l’auteure. Les questions étaient nombreuses : comment s’incorporer ? obtenir un numéro de charité? constituer un CA? organiser une AGA? Dans un premier temps, le Chic Resto Pop a agi comme incubateur des cuisines en mettant à disposition ses locaux. Il y a eu, entre autres, l’aide du Centre Saint Pierre et du CLSC pour rédiger un plan d’action et des règlements généraux et l’aide de Centraide pour la formation du CA et la mobilisation du membership.
Le pouvoir d’agir
Les participantes aux groupes de cuisines développent le pouvoir d’agir dans plusieurs sphères. Gertrude illustre cela dans des situations concrètes. Cuisiner en groupe diminue la charge mentale de la cuisine tout en valorisant celle-ci. Au quotidien, les femmes réalisent des économies d’argent. Elles dégagent même du temps pour l’aide aux devoirs. Grâce aux cuisines collectives, elles négocient des rabais avec les commerçants et démystifient les rouages du marketing (exemple : pourquoi traverser tout le magasin pour une pinte de lait). Siégeant dans des CA, elles apprennent la gouvernance et s’initient à l’exercice du pouvoir. Sur un autre plan, elles ne tarderont pas à pénétrer le milieu universitaire.
De l’éducation populaire à la recherche universitaire
L’Université de Montréal s’est intéressée au phénomène des cuisines collectives pour un projet de recherche par l’entremise de Relais Femmes. Un rapport de recherche a été publié et ceci a permis aux cuisines de développer un outil de formation. Les femmes de la CCHM sont ainsi passées de l’éducation populaire à la recherche universitaire. Par la suite, elles ont été invitées à un colloque à l’UQAM pour parler de leur expertise.
Un rassemblement national
Se regrouper rend fort, de sorte que la CCHM a créé le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) en 1991. Créer un rassemblement national a découlé de la volonté de se politiser davantage. Cette volonté est d’ailleurs venue d’une inspiration péruvienne après un stage de coopération internationale à Lima en 1990. Autrement dit, le RCCQ siège dans des tables de concertations, défend l’éducation populaire à l’échelle nationale et représente ses membres au secrétariat de l’action communautaire autonome. L’auteure dit : « En se joignant à ce monde du communautaire, nous étions bien entendu solidaires de ses luttes […], cela nous a amenées à créer des liens, que ce soit par choix stratégique ou par associations naturelles ».
En somme, évoluer d’une cuisine familiale à un mouvement de justice sociale, qui plus est porté par des femmes, est un sujet qui a mérité mon attention. Gertrude Lavoie compare les cuisines collectives à des ruches de miel et utilise la métaphore d’abeilles qui butinent et fabriquent du « nectar socialement nourrissant qu’on nomme la solidarité ». Écrit dans un style qui interpelle le lectorat, ce livre est une véritable école de la cuisine collective. Il saura sûrement vous plaire si le milieu communautaire vous passionne et particulièrement si vous animez une cuisine collective.